Share
" Mes très chers amis lecteurs, l'arrivée au monde de ce nouveau livre approche sans tarder et d'ici quelques jours, vous pourrez avoir entre les mains, sous les yeux, ce qui fut mon premier ouvrage narratif. Un roman autobiographique où fantastique et réalité s'unissent à tout moment pour entraîner le lecteur dans un voyage magique sans plus d'étapes que les toiles des grands peintres des XVIIIe, XIXe et début du XXe siècles, sans autre plateforme que des épisodes de ma vie.
Treize ans d'attente dans l'obscurité d'un tiroir, dans un coin de ma propre âme qui aboutira à la lumière. Plus en tant que mère qu'en tant qu'auteur, je vous confie le récit de mon histoire et j'espère, je souhaite, j'aspire à ce que vous lui donniez de l'amour, du temps, de l'attention et pourquoi pas : de l'imagination. Oui, parce que vous sentirez grandir les ailes de votre propre esprit et vos cœurs sauront vous guider jusqu'à ce que vous soyez près de Moi.
Reconnaissante d'avance et telle une petite fille enthousiaste, je vous livre un fragment de ce qui sera le premier symptôme (chapitre 1) de The Green Desk Disease, mon dernier livre."
Belén Hernández
SYMPTÔME 1 :
CRIER AVEC UN CRI
« Regardez l'homme dans sa sphère limitée, et vous verrez comment certaines impressions l'étourdissent, comment certaines idées l'asservissent, jusqu'à ce que, lui enlevant son jugement et toute sa volonté, elles l'entraînent à sa destruction. En vain un homme raisonnable et de sang-froid verra-t-il clairement la situation du malheureux, en vain l'exhortera-t-il ; C'est pareil à l'homme bien portant qui est au chevet du malade, sans pouvoir lui donner la moindre partie de ses forces... Car ce n'est qu'en s'efforçant de ressentir ce qu'il ressent que nous pourrons parler honnêtement sur le sujet. sujet" (Werther; Johann. W. Goethe)
00h30 ; 11 novembre 2009
Une autre nuit blanche arrive pour m'accompagner dans l'obscurité de mon esprit, dans le silence chaleureux du petit matin, dans le lent passage du temps où je m'entends sans interférence et sans interruption. J'éprouve ainsi le plaisir agréable de la solitude la plus intime et la plus réconfortante : celle de soi-même, celle que tant de gens craignent et à laquelle je désire tant.
La journée – comme d'habitude ces derniers temps – a été difficile – que dis-je dur ? C'était l'enfer ! —. Encore une bataille qui se termine sans savoir qui est le gagnant et qui est le perdant, mais à la fin la seule chose qui compte c'est qu'elle soit finie et cela signifie que, pour une raison étrange, le destin m'offre un nouveau jour à vivre, bien que ce ne soit pas encore un jour, spécialiste de ce qu'ils appellent vivre. A cet égard, je suis consolé par les paroles de mon bien-aimé JW Goethe et de son Faust : "La vie, combien la vivent et combien peu la connaissent !"
Avant de continuer, je préciserai que je n'utilise pas ces mots comme un reproche à ceux qui s'installent dans la tranquillité d'une pseudo-vie parce qu'ils n'ont pas appris que la souffrance pour autrui est une caractéristique innée et contraignante du verbe vivre. . Non! Nous ne sommes pas tous appelés à être des soldats courageux et vitaux ! En fin de compte, on peut dire que ce n’est qu’une question de chance.
Oui, heureusement, car certains d'entre nous semblent tristement voués à souffrir, d'autres savourent les plaisirs du bonheur et enfin, les premiers s'habituent à la souffrance et les seconds oublient le sens d'un tel sentiment.
Je ne sais toujours pas si la vie que j'ai dû vivre est vraiment la mienne ou si quelqu'un a commis une erreur en sortant d'une urne fermée un bulletin de vote ne comportant pas plus de lettres que mon nom. Peut-être que cette main bénévole innocente à qui on demande habituellement de faire le dessin avait tort. Je me demande : combien de dixièmes de seconde a-t-il fallu à ses doigts pour choisir le papier qui cachait mon nom ? Combien de bulletins de vote vos doigts ont-ils caressés dans l’obscurité de cette boîte qui contenait ma chance ? Avez-vous hésité à choisir un rôle ou un autre ?
J'ai envie de croire que les doutes l'ont envahi lorsqu'il a touché à cette poignée de noms et que c'est simplement une mauvaise décision qui l'a amené à sortir un petit morceau de papier avec mon nom griffonné dessus.
Cependant, je réalise que ces derniers temps j’ai envie de croire beaucoup de choses. Une question de chance ? Non, en tout cas, c'est une question de malchance et c'est pourquoi j'ai décidé de ne plus faire confiance à ces mains que l'on appelle "innocentes" et qui se camouflent parmi le public qui applaudit en contemplant le spectacle de la souffrance des autres. Quels spectateurs avec un si mauvais goût !
Quoi qu’il en soit, ces réflexions m’ont amené à entreprendre un dialogue approfondi avec moi-même. Je sentais que toute ma vie était en désordre, un chaos émotionnel régnait sans trône et il était temps de me mettre au travail et de nettoyer la pièce sombre où mon âme ne pouvait pas dormir. Je me suis perdu au milieu d'interminables divagations. J'avais soif de réponses. J'ai fait preuve d'une forte surdité envers le monde extérieur. Je me suis perdu dans la solitude de mes pensées et... Quand je me suis retrouvé épuisé par tant de fatigue vitale ; quand l'obscurité de mes yeux n'apercevait pas le moindre iota de lumière... Je me suis réveillé de cette léthargie douloureuse et j'ai compris quelle était l'erreur sur laquelle volait mon esprit sans trouver un endroit où atterrir. Tout était plus simple que je ne le pensais. J'avais commis la même erreur que le reste de l'humanité : je m'étais cru spectateur de la vie. Je m'étais installé dans une cour de sièges creux et silencieux parmi lesquels rien n'était représenté qui émeut mes sens. Sans hésiter je me suis levé à la recherche d'autres spectateurs, témoins d'autres temps et d'autres moments. J'avais besoin de retrouver des oreilles fraîches et propres, prêtes à écouter tout ce que j'avais gardé ces dernières années parce que je ne savais pas dans quel tiroir de ma vie le mettre. J'avais besoin d'un endroit où je me sentais à l'aise ou peut-être en sécurité. Il me fallait un refuge ou plutôt une belle scène où je pourrais représenter certains épisodes de ma vie.
Pour ce faire, il me suffisait de me rendre dans mon ancienne classe d'histoire de l'art et de me rasseoir devant l'écran où étaient projetées les images de ces lauréats qui sont passés à la postérité et ont gagné le titre d'objets d'étude. Ayant pris cette décision, je me suis rappelé le lendemain que j'allais raconter de la meilleure façon que je connaisse : en l'ornant de mots.
***
À 10 h 50 un vendredi de février 2008, je me suis assis à mon bureau vert au premier rang. C'était ma place. Que dis-je de mon site ? C'était mon territoire ! Tellement mien, que j'ai ressenti une véritable possession envers lui.
Avec la maladresse de mes mains froides, presque glacées et une odeur caractéristique de tabac entre mes doigts, je me préparais à placer ma loupe – désolé, ce n'est pas exact car ce que je plaçais à ce moment-là était mon petit œil ; ce petit œil qui me faisait me dépêcher d'écrire et de lire en même temps que mon esprit commençait à organiser des idées, des mots et des connaissances -, j'ai doucement saisi le stylo noir et ma main a commencé à parcourir une feuille de papier blanche et silencieuse qui donnerait chemin vers une petite lettre bruyante.
Après le rituel précédant la délivrance de l’examen, il est arrivé entre mes mains. Son objectif était de qualifier la thématique de l'Avant-garde Artistique du XXe siècle.
Avec un sourire confiant, je lisais les questions et sans difficulté, mon esprit ordonnait les réponses que ma main, tel un scribe obéissant, notait à la hâte. La surprise est venue lorsque le professeur a projeté "Le Cri" d'Edvard Munch.
J'ai lentement relevé la tête et j'ai soudain ressenti l'envie inquiétante de courir vers ce tableau. Je voulais y entrer pour me cacher dans ce coucher de soleil peint avec des traits nerveux et maladifs, teints de couleurs chaudes et lumineuses qui finissaient par mourir dans une masse de gris et de bleus. Je voulais traverser le pont peint par Munch et m'arrêter là. Je voulais voir un autre spectacle, peut-être une autre vie.
Sans hésitation, j'ai fait un pas en avant avec les pieds de mon esprit et suis entré dans cette scène peinte en 1893 (date qui curieusement était composée avec les mêmes chiffres que celle de ma naissance : 1983. Un siècle de différence me séparait du lieu). A cette époque, je voulais que ce soit ma maison).
Soudain, j'ai su que j'étais déjà là, à l'intérieur de cette boîte dans laquelle je voulais me cacher ou plutôt dans laquelle je voulais disparaître, ne serait-ce que pour quelques instants, de tout ce chaos qu'était devenue ma vie. Cependant, à mon grand étonnement, une fois à l’intérieur de cette dimension magique, je n’ai rien trouvé, absolument rien. Tout était de la couleur blanche du vide. Là où je voulais me cacher, il n’y avait ni ombres, ni couleurs, ni vie. Face à une telle déception, mes petits yeux ont commencé à avoir soif. Oui, ils voulaient surtout pleurer une tristesse liquide, car comme cela arrive souvent dans les rêves, ils se rendaient compte que dans cette dimension irréelle ils ne ressentaient pas de douleur et que la lumière de ce blanc resplendissant ne leur faisait pas de mal. Là, mes petits yeux étaient en bonne santé, rien ne les empêchait de faire ce qu'ils aimaient le plus : voir. Les larmes coulaient avec une telle violence que mes mains sont devenues un mouchoir de fortune qui s'est vite froissé à cause de tant d'humidité. C'est alors que j'entendis une voix qui me disait :
- Pourquoi pleures tu?
C'était la voix de Munch, qui me tendit avec inquiétude un mouchoir que je n'hésitai pas à accepter et une fois mes larmes essuyées, je rassemblai la force de lui répondre.
— Je pleure parce que je ne peux rien faire d'autre. Je pleure parce que je ne comprends rien à tout ce qui m'arrive. "Je pleure parce que personne ne répond à mes questions", lui dis-je d'une voix étranglée par le hoquet typique d'une gorge qui pleure.
"Peut-être qu'il est trop difficile de répondre à votre question", a-t-il suggéré.
— Non, je ne pense pas que ce soit si difficile de me dire ce qui ne va pas avec mes yeux ou quand ils vont aller mieux. Je ne veux pas rester comme ça pour toujours. "Ce n'est pas très difficile à comprendre", répondis-je.
- Tu as raison. Il est normal que quelqu'un qui souffre veuille savoir à quelle heure son malheur se terminera. La question que vous posez est formulée avec les questions de la peur et c'est naturel, a déclaré Munch.
- Savoir? Je pense que ce qui me fait le plus peur, c'est que j'ai le sentiment que cela ne va pas finir, bien au contraire : je pense que cela ne fait que commencer. Ma perte de vision n’est rien d’autre que le début de ce qui est encore à venir : j’ai avoué ma plus immense terreur de ces jours-là.
— Je ne peux ni affirmer ni nier ce que je ne sais pas. J'aimerais vous dire que tout ira bien, que tout passera et que ce qui vous fait peur aujourd'hui, demain ne sera même plus un souvenir. Mais je ne sais pas et je ne veux pas vous mentir avec des mots vides de sens ou des espoirs sur papier. «Je n'ai jamais aimé tromper les cœurs effrayés», m'a dit Munch en toute sincérité.
—Je ne cherche pas d'espoir ou de consolation, mais la vérité. De la vérité et un peu de sens à tout cela. Je veux croire que la douleur n’est pas stérile et que la souffrance a un sens.
— Oh, mon petit ! Vous vous trompez si vous pensez que la douleur est capable de générer quelque chose de bien ! Rien de cela. La douleur est un ventre desséché où le bonheur dort si profondément qu'il finit par mourir. "La souffrance parle un langage étrange qui n'est pas fait pour la bouche de l'homme", a déclaré Munch car, sans aucun doute, il avait déjà succombé aux espoirs volatiles typiques des malades en quête d'aide.
- Alors je fais quoi? Comment je vis? Savez-vous à quel point il est douloureux de réaliser que même si votre monde n’est rien de plus qu’un écheveau de fils d’acier enchevêtrés, rien autour de vous n’a changé ? Savez-vous à quel point il est triste de voir que la vie continue paisiblement pour les autres alors que la lumière s'éteint pour moi ? — Lui ai-je demandé, tournant injustement ma colère contre lui.
-Bien sûr que je sais. Je sais tout ce que tu me dis avec des mots amers, tu sais ? "Le monde, au début, vous écoute, vous réconforte, veut vous comprendre, mais un jour tout à coup, toutes ces nobles intentions disparaissent et vous n'avez plus d'autre compagnie que vous-même", m'a dit Munch avec un certain ton de reproche. .
"Pardonne-moi, j'avais oublié que tu étais aussi né pour souffrir..." dis-je embarrassé.
- Ne t'excuse pas. Il est naturel que vous ressentiez de la colère assaisonnée d’envie. Vous aussi, vous aimeriez ne pas vous éloigner du chemin tranquille d’une existence insouciante. "C'est compréhensible", m'a-t-il dit généreusement et a poursuivi : "J'ai une idée !" Puisque vous êtes venus me chercher dans ce lieu oublié sur aucune carte, faisons quelque chose ensemble, quelque chose d'inoubliable.
"D'accord, tu vas me dire ce qu'on peut faire dans le monde de l'Art", dis-je comme une fille qui vient de se faire une nouvelle amie.
- Nous allons peindre. Chacun se retrouvera face à une toile vierge pour meubler ses ressentis. Qu'en penses-tu?
- Je pense que c'est super. Je n'aurais jamais pu imaginer avoir un « expressionniste » comme professeur – j'ai répondu et rapidement, Munch m'a proposé les outils de sa créativité et a partagé ses pinceaux et sa palette avec moi.
Nous nous sommes livrés avec bonheur à nos toiles respectives, qui n'étaient que de minuscules restes de nos âmes avides d'être teintes d'ocres et de cobalt. Nous discutions avec animation tandis que de temps en temps nous nous éloignions de quelques mètres pour contempler de loin nos âmes perchées sur leurs chevalets respectifs. Nous avons mélangé les pigments et les avons baignés dans la térébenthine des larmes que mes yeux avaient distillées il n'y a pas si longtemps.
Je ne sais pas combien de temps nous avons été consacrés à nos toiles respectives. Cela a peut-être duré une éternité ou peut-être seulement quelques minutes, mais la vérité est que là, en respirant la palette de Munch, je me sentais en sécurité. C'était la première fois que je m'éloignais du monde réel qui, chaque jour, vacillait et détruisait un grain d'espoir de plus que je chérissais dans une sphère de verre, dans un sablier qui commençait à s'épuiser. Oui, en ces jours où mes visites chez le médecin s'étaient multipliées en raison des circonstances, mon espoir était devenu malade, le découragement et la réalité avaient infecté le virus de la peur et de l'impatience, mais surtout il s'était infecté d'une attitude dangereuse : la soumission. C’était la pire maladie qui puisse affliger une personne malade et, par conséquent, moi-même.
J'ai réalisé que depuis les premiers symptômes, j'étais dangereusement soumise à mon corps, à mon esprit, à mes sentiments, aux médecins... Tout était plus fort que moi et ainsi, je me suis abandonnée à un espoir si faible que je n'avais jamais existait. J'ai fait ce que font n'importe quel autre patient : j'ai été coopératif parce que je croyais toujours que j'avais confiance en ma guérison et je me suis réfugié chez les médecins. Cependant, l’espoir s’alliait à l’ignorance manifestée par le patient lors de ses premières visites chez le médecin. Ce mélange de sentiments – espoir et ignorance – est devenu dangereux et a fini par me priver de ma dignité. Je ne faisais plus confiance à rien ni à personne car ceux à qui je demandais de l'aide, confiaient mon corps et mes douleurs, étaient les voleurs de ma dignité et de mon espoir. Non contents de ce butin, ils ont volé mon nom et m'ont relégué parmi une poignée de symptômes non diagnostiqués. Il n'est plus qu'un de ses clients : « les clients de la santé ».
La situation s'est aggravée car ce n'était pas un cas facile à diagnostiquer et ils m'ont puni en ne recevant pas de traitement, encore moins un peu d'humanité. Je n'ai trouvé que des dos vêtus de blanc et j'ai entamé un long chemin d'appels à l'aide inutiles et que personne n'entendait. Ainsi, ceux qui auraient pu un jour être mes alliés, sont devenus des souverains despotiques en matière de santé ; Ils sont devenus des rois puissants qui ne voulaient pas écouter un mendiant qui demandait un peu de soulagement et de compréhension. Ils ont brisé ma volonté, ils m'ont laissé tomber à genoux et ont fini par me salir avec la poussière de leur indifférence.
Mes journées étaient prisonnières de la douleur et peu importait que les matins se réveillent en bleu ou en gris, car il n'y avait tout simplement plus de matins, ce n'étaient que des heures soustraites de ma vie ; Ils étaient perdus parce qu'il ne les avait jamais vécus, et donc l'avenir n'était pas différent de ce présent pénible. L'espoir reculait de plus en plus vite et les *puissants avaient déjà bouché leurs oreilles pour ne pas entendre mes appels à l'aide. On voulait me condamner au silence d'un malade non soigné.
J'ai tout abandonné et j'ai passé beaucoup de temps à panser mes blessures comme un animal effrayé. J'étais revenu à cet instinct primordial de réconforter sa propre douleur. J'ai gardé mon âme quelque part loin des puissants. La guerre entre eux et ma maladie a commencé et je ne m'inquiétais que de construire une tranchée qui protégerait mon âme.
C'est ce que j'ai dit à Munch pendant que nous terminions nos peintures et qu'il était temps de terminer nos œuvres.
- Vous avez terminé? Moi oui. "Je viens de donner la touche finale", a déclaré Munch.
"Oui… je pense que j'ai fini," répondis-je.
- Très bien. Que diriez-vous si nous nous montrions nos peintures terminées ?
"Eh bien, je veux savoir ce que tu as peint", lui dis-je et en même temps nous retournions nos toiles pour contempler ce que chacun de nous avait peint dans son âme.
Munch m'a montré son « Scream ». Il avait recréé à mes côtés ce qui serait sans doute l'un de ses tableaux les plus connus. Il a dit qu'en m'écoutant, il avait décrit la douleur, l'angoisse et la peur que je ressentais. Il avait utilisé des traits nerveux et des coups de pinceau tordus, le tout enveloppé de tons chauds et d'un tourbillon de gris. Même au loin, il avait repéré deux personnages s'éloignant de la scène principale. Il m'a avoué que ces marcheurs étaient les plus puissants qui ne voulaient pas m'aider.
J'ai tourné ma toile pour lui montrer et il a pu voir mon propre visage. Oui, j'avais fait le portrait de cette personne que nous avions abandonnée en classe d'histoire de l'art et qui continuait à écrire sous une grande loupe pour pouvoir voir sa propre écriture. Munch ne savait pas qui avait le plus peur des deux : son « Cri » tordu ou mon portrait enveloppé de tristesse solitaire. Après, nous sommes restés silencieux, il était temps de se dire au revoir et puis, comme Munch ne voulait pas dire le mot au revoir, il a pris son pinceau, l'a trempé dans une petite flaque de peinture verte qu'il n'avait pas utilisée dans sa peinture et avec d'un tendre chatouillement il traça un petit sourire d'espoir sur la ligne droite qu'était mes lèvres...

C'est ainsi que s'est terminée cette journée particulière où j'ai échappé aux mains d'un « expressionniste ». Munch ne m'a jamais promis d'espérer en écoutant mes peurs, mais il m'en a néanmoins donné un peu.
Ce jour-là, alors que je passais un examen d'Histoire de l'Art dans des conditions aussi déplorables, j'ai compris que "Le Cri" était devenu un miroir reflétant deux êtres effrayés qui se regardaient face à face, partageant leurs peurs et leurs misères car tant son auteur que moi, nous étions deux malades à la recherche d'un puissant pour soulager nos douleurs. Le moment le plus triste était passé et j'ai décidé de continuer à chercher des téléspectateurs d'autres époques à qui je pourrais montrer et avouer tout ce que personne dans le monde réel ne voulait voir, et encore moins entendre.
J'ai décidé de partir à la recherche d'un peu du bonheur que l'Art me gardait. Avec cette mission, j'avais l'impression d'appartenir au mouvement artistique appelé "The Bridge" et dans lequel mon bien-aimé Munch avait développé son travail. Oui, il me fallait maintenant traverser ce pont pour entamer bien d’autres conversations qui ne pouvaient être reportées ; à des conversations avec d'autres œuvres et auteurs qui ont contemplé le contemplateur.
D'ailleurs, cette journée que je vous ai racontée s'est terminée lorsque j'ai remis mon examen, le même que j'ai écrit avec un cœur empoisonné par l'angoisse et que ma souffrance m'a dicté. Au cours des semaines suivantes, je ne savais plus rien de l'examen au cours duquel j'avais une conversation pointue avec moi-même. Un jour, le professeur est arrivé avec les notes et j'ai regardé avec ma loupe dans la marge droite de la page : Un dix ! J'en ai eu un dix !
A voix basse je murmurai : "Il n'y a rien de mieux que d'écouter les dictats de l'âme même s'ils proviennent des échos de l'angoisse..."

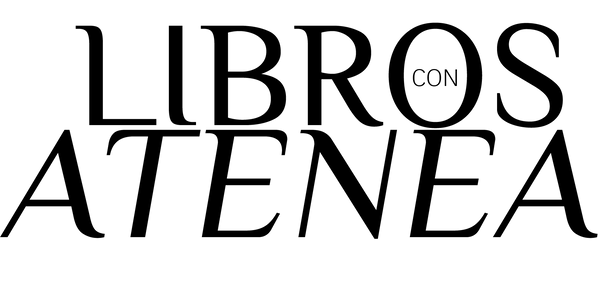

4 commentaires
Esta historia comenzo con una carta que le pensaba mandar a Belen Hernandez Segura, pero al pensarla bien me di cuenta de que deberia contarle muchas cosas que ella desconoce sobre mi, de quien no guardara buen recuerdo por una desafortunada critica que le hice, y que si no se las contaba no hiba a entender muchas cosas, pero contarselas sifnifica un monton de paginas que no se si tendra la paciencia o el gusto de leerlas, pero parafaseando un poco a Tomas Heloy Martinez, que al menos quede grabada en esta especie de carta documento, una verdad que mereceria estar gravadas, como el dice, en las rocas de la eternidad.
Entonces, mi querida Belen, voy a escribir esta verdad que quiero que sepas porque se que la entenderas, con tus sentimientos y tu dolor entenderas a alguien que esta pasando lo mismo. Se que Ines vive en una de sus estancias en Santa Cruz, una provincia Argentina, al sur, la encontre en facebook…pero no tuve el coraje de escribirle…tal vez por eso te escribo a vos.
Primero tienes que conocer como llegue a la casa de Ines, cuyo apellido es Garcia Merou, una de las familias mas adineradas y de abolengo de Argentina. Por eso te mando un pedazo de mi biografia donde explico un poco como Zulema, en ese tiempo una mujer poderosisima, llego a mi vida.
Todo comenzó cuando leí un artículo en la antigua revista “Gente”, un artículo o reportaje, no recuerdo bien, se titulaba “Mire esta Cara” y como es lógico estaba impresa la cara de un tipo, de un pobre tipo que se había pasado treinta años preso en el manicomio de Vieytes (donde aún trabajaba Pedrito) y después se descubrió que era inocente.
No sé cómo vino a parar a mis manos esta revista, porque ese tipo de publicaciones, donde en casi todos los números salen un par de artistas casi desnudas, estaban prohibidas, una especie de censura como para que los presos no se hicieran mucho la cabeza.
En las celdas de aislamiento cada cubículo era ocupado por dos presos, eran diez celdas, una al lado de la otra, que daban a un pequeño patio donde pasábamos la mayor parte del día, dado que las celdas estaban siempre abiertas.
Yo estaba en una con otro compañero de infortunio y en verdad, aquel artículo, escrito por un periodista que se llamaba Barbe, me impresiono mucho y decidí escribirle una carta . Recuerdo que mi compañero de celda me dijo que no perdiera tiempo, que no me darian importancia, pero en realidad eso no me importaba, me importaba más que el que escribió aquello supiera que sirvió para algo, para darle ánimos a un adolescente perdido por los caminos de la vida, no sé, que supiera que escribió algo con sentido humano y que alguien lo sintió así y se lo hacía saber. A veces pienso que los libros que estaba leyendo estaban teniendo una influencia positiva en mi torcida personalidad.
Escribí la carta y la mande, con la dirección de la revista, pero como la mande a nombre del periodista, no tuvo problemas en pasar por la censura, la verdad es que no recuerdo si la mande a través del corno penitenciario o si se la día a mi madre en la visita para que la mandara desde afuera, esto se podía hacer porque las visitas eran revisadas al entrar pero no al salir. El asunto es que después me olvide por completo de aquello, no esperaba nada de esa carta, era algo que yo había hecho sin esperar nada a cambio.
Pero el destino tiene esas cosas de loco que nunca voy a entender, puede ser el destino, puede ser Dios…no sé, pero hay cosas que pasan y que uno ni remotamente tiene el coraje de imaginar.
Recuerdo que era de tarde y yo estaba en el patio de las celdas jugando a las damas con un compañero de encierro, (que era más bruto que un arado pero que a las damas era muy difícil ganarle), cuando escuche que por los altoparlantes me nombraban y agregaban »prepararse para dirección”. Esto significaba que el “Taquero” quería hablar con uno, si uno no había pedido “audiencia” y pasaba esto seguro que había algún problema serio.
Me vestí con lo mejor que tenía y espere que me viniera a buscar el guardia que me llevaría a la dirección. Recorrimos los tres pisos pasando por infinitas rejas que se habría y se cerraban a nuestro paso, en cada una repetía lo mismo; “ a la dirección”… “a la dirección”, así hasta llegar al despacho del director El guardia golpeo de leve con los nudillos, después abrió un poco y metiendo la cabeza adentro dijo algo que no alcance a escuchar parado a unos diez metros y con las manos en la espalda, como era obligación. Grande fue mi sorpresa cuando en vez de decirme que pase, el “taquero” salió de su escritorio y vino a mi encuentro. Este maldito tenía la puta costumbre que nos dejaba locos a todos los presos; cuando se acercaba a conversar con algún “interno”, como nos llamaba, le comenzaba a pellizcar un costado de la cintura mirándolo a los ojos, y pellizcaba fuerte el desgraciado. Uno debía contestarle, se suponía, sin realizar ninguna muesca de dolor…eso era por lo menos lo que yo intentaba.
Se acercó, me pellizco y me dijo en tono cabrero;
., Vos escribiste una carta a una revista.?
Se me helaron las bolas, lo único que atine a decir fue;
. No dije nada de nada sobre la cárcel, jefe.
Me dejo de pellizcar y dijo;
.Ya sé, entra a la dirección que hay alguien que quiere hablar con vos.
Yo no entendía nada pero me acerque a la puerta y la empuje.
En el escritorio del director no había nadie, el diré no me había seguido así que di un paso al interior y entonces la vi; sentada en un sofá que había a un costado estaba una rubia de unos cuarenta años, muy distinguida…muy elegante, vestida con una pollera negra y una blusa dorada, casi del color de su pelo. Se sentía que en esa mina había guita y distinción. Cuando me vio se levantó para saludarme y dijo; Hola, como estas.
Era una hermosa mujer pero yo no tenía idea quien carajo era, porque estaba allí ni que pito tocaba yo en esta situación.
Se acercó, me dio un beso en la mejilla y a modo de presentación me extendió una revista “Gente” abierta en el “Correo de los Lectores”. Para mi sorpresa, aquella carta que yo le había escrito al periodista Barbe estaba allí, como si yo la hubiese escrito al correo de los lectores, al pie de la carta estaba mi nombre> la dirección, la carta, por su contenido, evidenciaba que el que la babia escrito estaba preso.
La mujer comenzó diciéndome que por ahora solo iba a saber que se llamaba Zulema que se había conmovido al leer mi carta y que había decidido conocerme y eventualmente ayudarme de alguna manera. Me dio una caja de “Chesterfield”, que seguían siendo lo máximo en cigarrillos, conversamos un buen rato sobre mi vida, mi pasado y la vida en la cárcel, lo único que recuerdo es que le dije que si no la veía nunca más, con lo que había hecho, solamente por aquella visita, yo no la iba a olvidar nunca. Claro que esto fue un golpe bajo mío; no entendía que estaba pasando pero me di cuenta en el acto de que podía sacar ventaja de esa situación. Además la mujer tenía un excelente cuerpo y esto me había entusiasmado, no sé porque, era una mujer hermosa, distinguida y de suaves modales, aquellas con las cuales uno no tiene ni coraje de soñar que puede llevar a la cama. Pero lo mismo me había pasado al conocer a Betty y a Tamara… no pensé que pudiera acostarme con ellas.
Tres días después Zulema volvió y nuevamente se cumplió eso de “prepararse para la dirección”, esto quería decir que fuese quien fuese, esta mujer era importante en serio. Si no lo fuese, tendría, como mucho, una” visita especial” y se llevaría a cabo en el locutorio o en la sala de abogados, y esto ya era una excepción muy rara, ahora eso de recibir visitas en el despacho del director…..
Bueno, esto explica como conoci a Zulema, por un escrito mio, a pesar de ser, en ese momento, un delincuente preso purgando una condena. Demas estar decir que con la influencia de Zulema, un par de meses despues sali en libertad. Y el problema nacio alli; Zulema me quiso integrar a la alta sociedad argentina que ella frecuentaba, me mostraba como un trofeo, y los de la alta me habrian la puerta porque venia de la mano de ella. Y asi fue como un dia me llevo al departamento de Ines. Fue exepcional. Ines tocaba el piano y la guitarra y cantaba en portugues y frances (por cierto, muchas de esas canciones aun las toco en la guitarra)
Daba aulas a los de la alta sociedad, en cuanto nos conocimos se establecio un lazo increible entre los dos, a mi me facinaba el portugues y ella lo hablaba muy bien, igual que el frances, y sabia todas las musicas de Chico Buarque, Roberto Carlos y otros idolos mios.De ahi en mas me tomo de alumno y tre s veces por semana iba a disfrutar, mas que a aprender, de la compania de Ines. Ella no veia muy bien, por una enfermedad que tenia, y yo la acompañaba hasta el ventanal desde donde se veia el rio de la Plata, y le contaba si estaban pasando barcos, el color del agua y eso…ella nunca salia de su casa, pero era una persona tan tierna, tan instruida, tan
Suave que era una delica cantar y estar junto a ella…como es natural nos enamoramos.
Y ese fue el problema; se lo conte a Zulema, que se lo conto a la madre de Ines, que se lo conto a su marido, que casi se vuelve loco; como podia atrevese es ex presidiario, sin apellido ni abolengo, hijo de inmigrantes tener el tupe de decir que esta enamorado de mi hija…y mas, quien metio en mi casa al personaje.. El padre de Ines llamo al general Julio Rodolfo Alsogaray, Comandante n Jefe del Ejercito, que y le pidio explicaciones sobre el actuar de su mujer, exijiendo de que si ella lo metio que ahora lo saque…pero que no haga sufrir a Ines.
. Eso lo resuelvo yo en dos dias…a mi tambien me tiene cansado.
Fue la laconica respuesta del general….y mi suerte estaba hechada.
El general me odiaba pero me tenia que aguantar….era una especie de venganza de su mujer por algo que yo no sabia. Era su oprtunidad.
Pero ete aqui que el diablo o dioas metio la cola y esta conversacion fue escuchada por Juan Carlos Alsogaray , hijo menor del general y Zulema y que años despues fue asesinado por el ejercito argentino, y cuyo sobrenombre era «Lalo» y no «Paco» como fue conocido cuando era montonero. Resulta que Lalo no era tonto y sabia que para hacerme deaparecer solo habia un metodo, porque en cualquier otro entraria Zulema, y ese metodo era hacerme matar en un enfrentamientp ficticio con la policia o directamente meterme en un «vuelo de la muerte» o algo parecido.
Lalo. Que era un hombre de principios y que tiempo despues se fue a estudiar a La Sorbona» y estuvo en la toma del 68, no dejo por menos : diez minutos despues se aparecio en el departamento de la calle Bilinghur donde yo estaba parando. Me explico la situacion y me dijo que tenia que desaparecer, porque su madre no hiba a pode ayudarme en esta. Me dijo que no sabia a donde pero que me fuera o era hombre muerto.
Ese dia tenia aula con Ines a la tres. Legue muy confundido, no podia decirle la verdad sin destrozarla y crear un drama familiar que me impediria volver a verla. Mejor seria desaparecer simplemente…abandonarla. Ella me sintio desolado y me pregunto que pasaba, le conte una historia de un viaje que tenia que hacer pero que no tenia en ese momento dinero. Ella gentilmente me dijo que tenia 700 dolares, que si queria me los prestaba.
No se los podia aceptar porque no habia muchas posibilidades de que se los pudiera devolver, pero asi mismo era la excusa exacta para apartarla de mi vida, pensaria que era un sinverguenza barato que la engaño por 700 miserables dolares…ese era el precio del amor que juraba. Acepte los 700 dolares sabiendo que ni ellos ni yo volveriamos a ese departamento, pero Ines sufriria menos siendo estafada en dinero que abandonada por desamor…en aquel tiempo crei eso.
La verdad es esa, Belen Hernandez. Algo asi como «La Princesa y el Vagabundo»….ahora veo que hubiede sido mejor decirle la verdad y afrontar las consecuencias, pero tenia 20 años…y hace mucho, mucho tiempo.
Gabriel Criscuolo
Santa Cruz de la Sierra
6/7/2024
Apreciable Belén. He leído y he sentido. Vivir es pensar para la mayoría de los que hemos pretendido dedicarnos a algún tipo de arte. Eso hace más intenso el sufrimiento pero a la vez nos va dando las claves para ir pasando con mayor dignidad cada día, que empieza gris y termina resplandeciendo con alguna esperanza. Me ha complacido leer una parte de tu obra y así conocer mejor a los seres que te conforman. Un abrazo.
Querida amiga, me has engañado con eso de que este libro era de prosa poética. Es una prosa de verdad, que engancha, al alta calidad. Me siento afortunado que nos conozcamos y colaboremos más allá de la poesía que nos unió. Este es un libro ALTAMENTE RECOMENDABLE. Lo digo en alto por si no se me escucha.
Te regalo este poema 267 de ZenObio porque ha sido leerte y acordarme:
No precisa de pisotón
La cucaracha
Ni provoca el grito
La araña
Ni nos invita al bofetón
La mosca
O el mosquito.
Vemos con nuevos ojos
Una tierra nueva,
Un nuevo cielo,
Un espíritu nuevo.
Desgarrador.Asi senti este primer contacto con el pupitre verde, mas solo quien a pasado por algo similar a de entenderte perfectamente Poeta…a mi me toca acompañarte